
Mois : mai 2025


Entrisme des Frères musulmans : offensive sur l’université
L’université française est, depuis plus de vingts ans, le théâtre de l’entrisme idéologique des Frères musulmans. Dans un article du Point, Géraldine Woessner retrace cette lente progression à travers une série d’incidents, de Lyon-2 à Nanterre.
À Lyon-2, l’hommage du vice-président Willy Beauvallet au chef du Hezbollah et la censure violente d’un cours du géographe Fabrice Balanche ont révélé, selon Olivier Vial, directeur du CERU, « un climat d’omerta » où se conjugue militantisme propalestinien et prosélytisme religieux. Mais la situation excède de loin ce campus : projections pro-hidjab à Sciences Po Paris, conférences antilaïques à Toulouse ou Lille, pressions quotidiennes décrites par des enseignants de Nanterre, prière organisée et port du voile intégral se banalisent sans réaction institutionnelle.
Pour Olivier Vial, le phénomène est tout sauf spontané : il s’inscrit dans la stratégie séculaire des Frères musulmans, « l’islamisation par l’éducation ». Il rappelle que la branche étudiante de ce mouvement, Étudiants musulmans de France (EMF), est née en 1989 à Bordeaux avant de prendre son nom actuel en 1996 . La filiation idéologique se manifeste également par l’affiliation d’EMF au Forum of European Muslim Youth and Student Organisations (FEMYSO), soupçonné d’être la vitrine jeunesse de l’UOIF.
Face aux premiers coups de projecteur médiatiques, EMF a choisi la discrétion. « EMF a su s’adapter pour rester dans l’ombre », note Vial : en troquant la revendication ouverte pour des actions caritatives – maraudes, banques alimentaires, tournois sportifs – l’association « normalise » une présence religieuse dont la portée politique demeure intacte. Cette tactique d’esquive, Olivier Vial la résume ainsi : « C’est le syndrome Dracula : une fois mis en lumière, ils se sont évanouis. »
Aujourd’hui, observe-t-il, la rhétorique de « l’islamophobie » joue le rôle d’un bouclier : toute critique, même factuelle, est rejetée comme raciste ou complotiste, paralysant la riposte universitaire. L’essentiel, conclut Olivier Vial, est donc de rompre le déni : reconnaître le travail de sape méthodique à l’œuvre dans les amphithéâtres, réaffirmer le principe de laïcité et soutenir les enseignants qui osent nommer les faits. Sans cette prise de conscience, l’université risque de devenir « le laboratoire silencieux d’une radicalisation progressive »
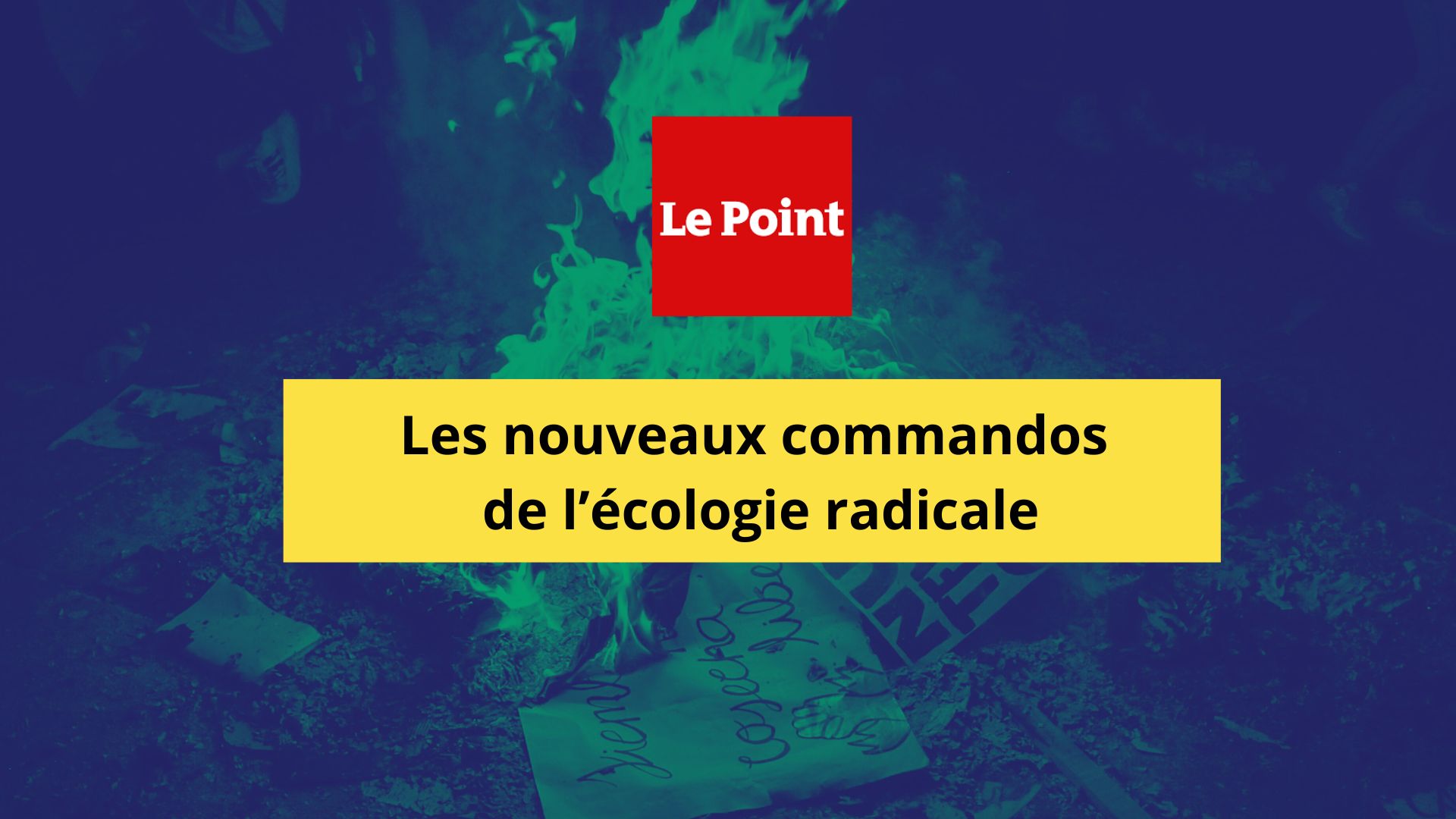
Les nouveaux commandos de l’écologie radicale
Deux incendies criminels contre des coopératives agroalimentaires bretonnes, suivis d’une attaque contre un McDonald’s près de Toulouse, marquent la naissance des FRITES, le Front révolutionnaire intergalactique et territorial en sauce. Leur signature ironique contraste avec la gravité des dégâts – 400 000 € à Plouédern, un bâtiment détruit à Mellac – et les menaces qui pèsent désormais sur le fabricant de chips Altho-Brets.
Pour Olivier Vial, directeur du CERU et de l’Observatoire des radicalités, ces coups d’éclat traduisent « la brumisation des contestations » : « Les idées radicales sont dans l’air, martelées par tout un écosystème médiatique ; elles inondent les réseaux sociaux. » Autrement dit, plus besoin d’une organisation structurée : l’atmosphère idéologique suffit à « créer des consciences énervées » aptes à basculer dans la violence. Là où, hier, les militants se formaient au sein d’ONG ou de collectifs visibles, « les jeunes se radicalisent seuls via des médias militants », dont les enquêtes à charge désignent cibles et « responsables ».
L’ampleur du phénomène reste souterraine mais tangible. Un sondage Odoxa pour Coriolink rappelle que 70 % des Français condamnent ces violences ; pourtant, prévient Vial, « 17 % approuvent les menaces contre les responsables de travaux ». C’est, dit-il, « considérable » : la preuve d’une « fracture de plus en plus béante » où un récit minoritaire mais contagieux légitime l’intimidation au nom d’une « guerre sainte anticapitaliste ». Le danger tient moins à la force des effectifs qu’à la logique virale : « Ce n’est plus une organisation, c’est une logique », conclut Vial, soulignant l’impuissance des autorités face à ces actions low-cost, décentralisées et inspirées par les théories éco-insurrectionnelles d’Andreas Malm. Faute d’analyse nationale et de stratégie cohérente, les enquêtes piétinent ; la brèche idéologique, elle, demeure grande ouverte.