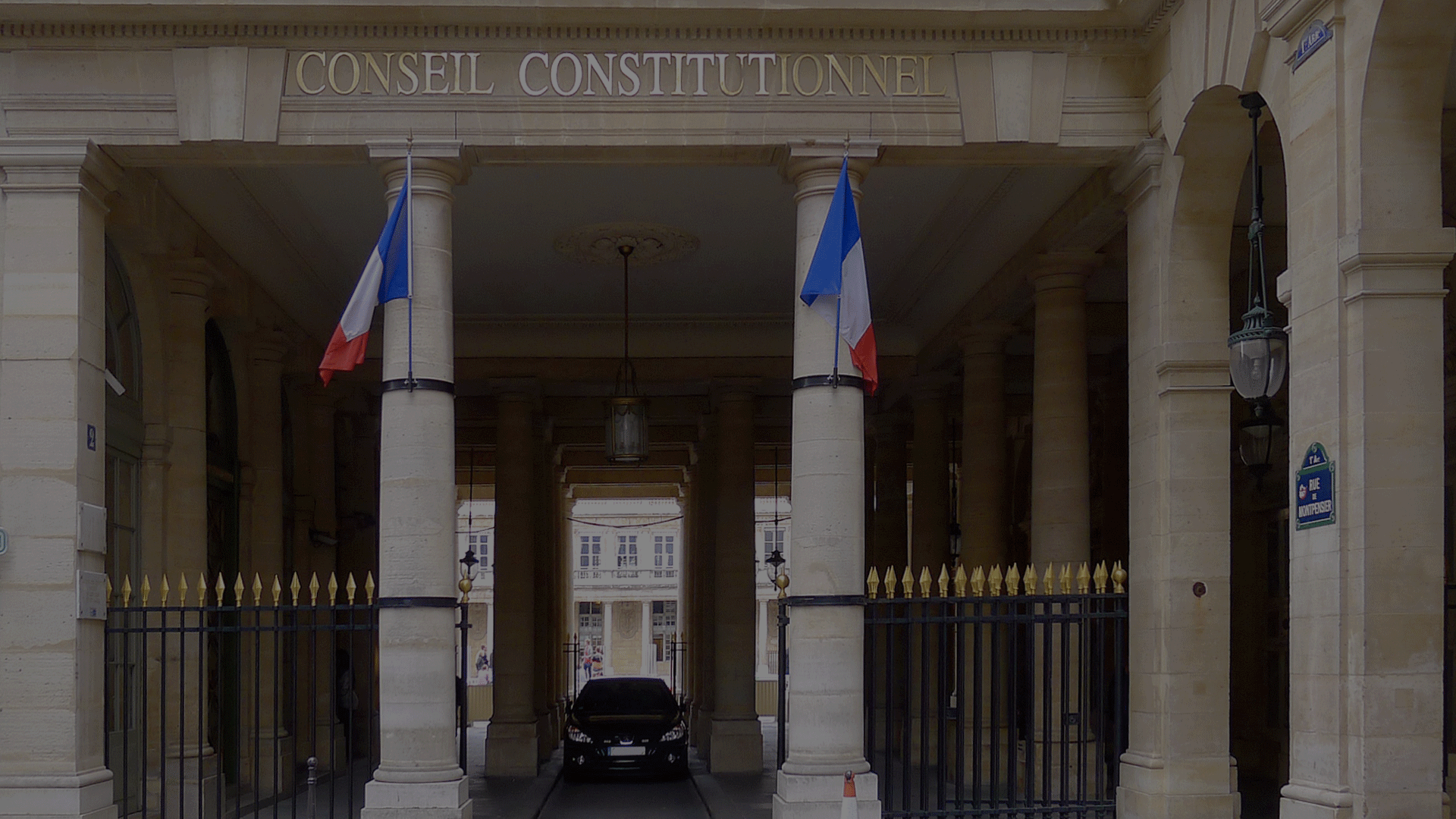Texte publié le 21 janvier 2019, dans le Figaro
Le 22 janvier, la France et l’Allemagne vont signer le traité d’Aix-la-Chapelle sur la coopération et l’intégration franco-allemandes. Trois remarques préalables sont à faire.
- C’est la date anniversaire du traité de l’Élysée du 22 janvier 1963 que le Bundestag avait sciemment torpillé par l’ajout irrégulier d’un préambule réaffirmant l’importance, pour l’Allemagne, d’ «une étroite association entre l’Europe et les États-Unis».
- Le lieu n’est pas fortuit: Aix-la-Chapelle fut la capitale de l’Empire franco-germain de Charlemagne.
- L’intitulé du traité n’est pas davantage fortuit: c’est, à travers l’«intégration», la reprise du projet fédéralisant, mis en échec, pourtant, par le peuple français, lors du rejet massif du projet de «Constitution européenne» par référendum, le 29 mai 2005.
Or le président de la République qui a négocié ce traité (comme le prévoit l’article 52 de la Constitution) est aussi celui que sa fonction désigne comme le garant de l’indépendance nationale explicitement (article 5 de la Constitution) et donc de la souveraineté nationale implicitement (article 3). Et il a à le faire en veillant au respect de la Constitution (article 5), ce qui est loin d’être le cas par les six motifs suivants, dans l’ordre du traité d’Aix-la-Chapelle.
Selon le préambule de ce traité, est réitérée la volonté d’une Union européenne «souveraine», alors que cette organisation internationale n’est pas un État, seul appelé à la souveraineté, et que sur le territoire français, la souveraineté n’est pas autrement que «nationale», exercée par le peuple français auquel elle appartient.
«Selon le traité, »un membre du gouvernement d’un des deux États prend part, une fois par trimestre au moins et en alternance, au Conseil des ministres de l’autre État »»
L’article 4 du traité stipule que la France et l’Allemagne «se prêtent aide et assistance par tous les moyens dont ils disposent, y compris la force armée, en cas d’agression armée contre leurs territoires», ce qui répète inutilement l’assistance mutuelle prévue par l’article 5 du traité de Washington du 4 avril 1949 instituant l’Otan, mais pour lui donner, ici, un caractère obligatoire qu’elle n’a pas, pour chacune des parties dont la France, dans le cadre de l’Otan. Créer par le traité d’Aix-la-Chapelle une obligation pour l’État français, qui plus est en matière de défense, c’est, en soi, une atteinte à la souveraineté nationale pour ne rien dire d’une stratégie de dissuasion nucléaire qui ne peut être que nationale.
En outre, l’article 5 du traité prévoit que les deux États «établiront des échanges au sein de leurs représentations permanentes […], en particulier entre leurs équipes du Conseil de sécurité» des Nations unies. Est-ce à dire que la France pourrait être représentée par des politiques ou des diplomates allemands au sein du Conseil de sécurité dont, contrairement à l’Allemagne, elle est membre permanent, avec droit de veto? Ce serait là une atteinte à la souveraineté nationale.
Par ailleurs, l’article 14 institue «un comité de coopération transfrontalière comprenant des parties prenantes». Le traité les énonce, ajoutant à chaque État, «les collectivités territoriales, les parlements et les entités transfrontalières comme les eurodistricts et, en cas de nécessité, les eurorégions intéressées». Est-ce que la future «collectivité européenne d’Alsace» sera une des parties de ce traité international qui est conclu et ne peut être conclu qu’entre deux États souverains dont la France, en méconnaissance du caractère constitutionnellement unitaire de la République française (article 1er de la Constitution)? Alors qu’au surplus, l’État admet d’insérer ces collectivités territoriales et autres personnes publiques dans le champ des relations internationales qui sont, partout en France, un monopole de l’État (comme l’a souligné le Conseil constitutionnel dans sa décision du 12 février 2004).
De plus, la revendication du bilinguisme apparaît au détour de l’article 15 du traité d’Aix-la-Chapelle, d’ailleurs réduite à un objectif dans les territoires frontaliers. Bien entendu, il ne s’agit nullement ici de rattacher l’Alsace à l’Allemagne ou, même, de «germaniser la plaine»: il faut savoir raison garder. Mais la langue de la République est bien le français, comme le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de l’affirmer dans sa décision du 15 juin 1999, et l’exclusivité de la langue française vaut dans la sphère publique, ainsi qu’il l’a souligné dans sa décision du 29 juillet 1994.
«Il est grand temps de mettre une question européenne, telle que ce traité, dans la campagne des élections européennes»
Or quelle garantie, autre que celle de la Constitution, peut être donnée contre le recours à l’allemand dans les services déconcentrés de l’État en Alsace-Moselle, mais aussi dans ceux des communes, établissements publics de coopération intercommunale ou départements? Et la même question vaut d’être posée pour les services des eurodistricts ou eurorégions, sur le territoire français, ainsi que pour ceux de la prochaine «collectivité européenne d’Alsace», nouvelle tentative de suppression des départements du Bas-Rhin et du Rhin, pourtant refusée par référendum local, le 7 avril 2013.
Enfin, selon l’article 24 du traité d’Aix-la-Chapelle, «un membre du gouvernement d’un des deux États prend part, une fois par trimestre au moins et en alternance, au Conseil des ministres de l’autre État». Or le Conseil
des ministres français a des attributions constitutionnelles, par exemple pour délibérer un projet de loi (article 39 de la Constitution) ou pour autoriser le premier ministre à engager sa responsabilité sur un texte (article 49). Il y a donc là une atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale.
Dès lors, il importe qu’après sa signature, au plus tôt, et l’autorisation de sa ratification, au plus tard, le Conseil constitutionnel soit saisi, sur le fondement de l’article 54 de la Constitution de 1958, en vue de vérifier la constitutionnalité du traité d’Aix-la-Chapelle afin de dire les nombreux obstacles à l’autorisation de sa ratification en l’état. Cette saisine peut être celle du président de la République, lui-même, ou, à défaut, celle du président du Sénat ou d’au moins soixante parlementaires. C’est indispensable, car il est grand temps de mettre une question européenne, telle que ce traité d’Aix-la-Chapelle, dans la campagne des élections européennes, celle qui se profile derrière l’écran de fumée du «grand débat national». Ce n’est que sur une base juridiquement solide et politiquement légitime que la construction européenne pourra se poursuivre et même reprendre, certainement pas contre la souveraineté intangible des États et sans l’accord exprès des peuples, sinon à ses risques et périls. Cela vaut pour la coopération franco-allemande, à présent, comme pour l’Union européenne, bientôt.